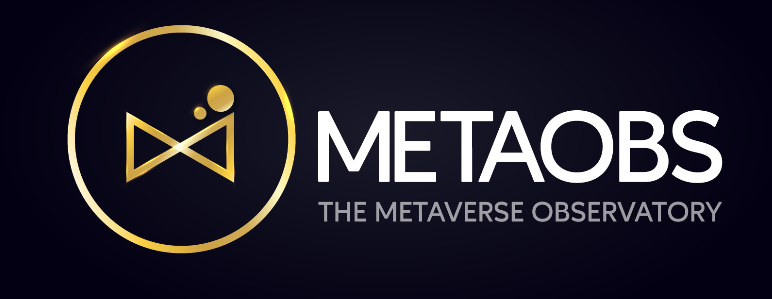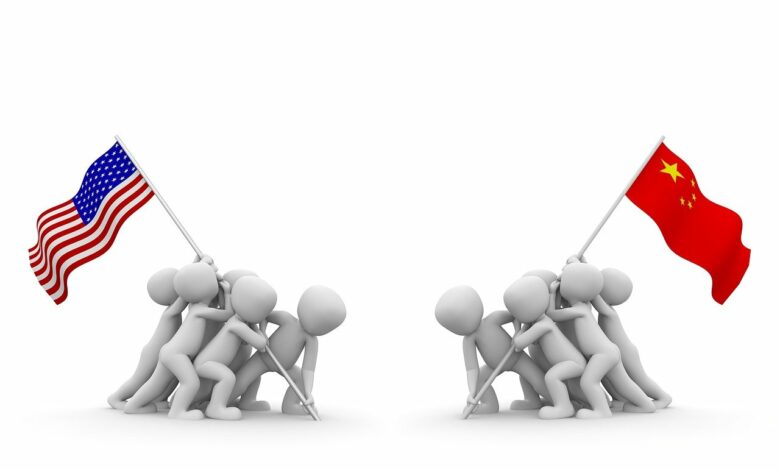
Par Frederik Dembak, directeur en Chef adjoint Investissement
L’illusion d’un terrain de jeu égal
On aime répéter que l’intelligence artificielle est « mondiale ». C’est faux. En réalité, deux blocs dominent : les États-Unis et la Chine. Le reste du monde, Europe en tête, se bat pour rester dans la course. Or les choix que font aujourd’hui les décideurs européens – en matière de régulation, d’investissement et de souveraineté – pèseront lourd dans dix ans.
Mario Draghi l’a dit sans détour cet été : « L’Europe est en train de décrocher. » Et ce n’est pas un ancien banquier central qui parle pour la beauté du verbe : c’est un constat fondé sur des chiffres.
Le gouffre en investissement
Les États-Unis dépensent environ trois fois plus que l’Europe en capital-risque lié à l’IA. La Chine, elle, déverse des milliards à travers des fonds d’État et des plans quinquennaux, souvent orientés vers des applications stratégiques (sécurité, armée, surveillance).
Face à cela, l’Europe aligne des initiatives dispersées : des fonds nationaux ici et là, une Banque européenne d’investissement qui avance prudemment, et quelques champions isolés (Mistral, Aleph Alpha) qui finissent souvent par lever aux États-Unis pour croître plus vite.
Ce qui frappe surtout : le décalage dans les infrastructures. Les grands modèles d’IA consomment une puissance de calcul gigantesque. Aujourd’hui, la majorité de cette puissance reste concentrée dans les datacenters américains (Microsoft, Google, Amazon). L’Europe achète des crédits de calcul… comme on achèterait du pétrole.
Régulation : force ou frein ?
L’Europe est pionnière sur la régulation. L’AI Act, adopté en 2024, est déjà perçu comme une référence mondiale. Mais la question divise : est-ce un boulet ou une opportunité ?
- Le risque : en imposant des contraintes lourdes, l’UE peut décourager les start-ups locales et les pousser à s’installer ailleurs. Meta a déjà refusé de signer le Code de pratique européen sur les IA généralistes.
- L’opportunité : si l’UE réussit son pari, elle peut créer un label de confiance, un « CE » de l’IA, qui deviendra un passeport mondial. Exactement comme elle l’a fait avec le RGPD, finalement copié un peu partout.
La vérité, c’est que cette carte de la régulation peut être un levier géopolitique autant qu’une contrainte économique.
Le piège de la dépendance technologique
Ce que beaucoup de dirigeants n’osent pas dire tout haut : l’Europe dépend presque totalement des États-Unis pour les briques essentielles de l’IA.
- Puces : NVIDIA fournit plus de 80 % des GPU utilisés dans les modèles de pointe.
- Cloud : Microsoft Azure, AWS et Google Cloud captent la majorité du calcul nécessaire.
- Modèles : OpenAI, Anthropic et Google dominent la scène, avec une avance difficile à rattraper.
Cette dépendance n’est pas seulement économique, elle est aussi stratégique. Que se passerait-il si les États-Unis décidaient demain de restreindre l’exportation de certains modèles ou de certaines puces vers l’Europe, comme ils l’ont déjà fait vis-à-vis de la Chine ?
Où l’Europe pourrait surprendre
Ce tableau sombre ne doit pas masquer les zones où l’Europe peut jouer une carte gagnante. Trois domaines se distinguent :
- IA de confiance et explicable : dans les secteurs régulés (finance, santé, assurance), les entreprises cherchent déjà des solutions conformes aux standards européens. C’est un marché naturel pour des champions locaux.
- IA verte : l’IA consomme énormément d’énergie. Or l’Europe, avec sa tradition d’innovation énergétique et environnementale, peut devenir pionnière dans l’optimisation éco-responsable des modèles.
- Secteurs stratégiques ciblés : au lieu de courir derrière les modèles généralistes américains, l’Europe pourrait miser sur des IA spécialisées de très haut niveau, par exemple pour la médecine personnalisée ou l’ingénierie industrielle.
Ce sont des niches, certes, mais des niches où l’on peut devenir incontournable.
Ce que les décideurs européens doivent anticiper
Attendre une « souveraineté totale » serait une chimère. Mais il existe des leviers réalistes :
- Consolider les acteurs européens : éviter la dispersion des fonds et soutenir quelques champions identifiés, même si cela suppose des paris risqués.
- Créer des partenariats stratégiques avec l’Afrique et l’Amérique latine pour accéder à des données diversifiées et à de nouveaux marchés.
- Investir massivement dans le calcul : le projet EuroHPC, qui vise à déployer des supercalculateurs européens, doit devenir une priorité politique au même titre que l’énergie ou la défense.
- Penser la régulation comme arme d’influence : faire du « made in Europe » un synonyme de sécurité et d’éthique, et exporter ce standard.
Choisir son rôle avant qu’il ne soit choisi
Si l’Europe continue sur sa trajectoire actuelle, elle risque de devenir un simple marché de consommation pour les technologies américaines et chinoises. Mais avec une stratégie lucide – miser sur la confiance, l’énergie, et quelques secteurs stratégiques – elle peut encore influencer les règles du jeu.
La question n’est pas de savoir si l’Europe rattrapera les États-Unis ou la Chine : elle ne le fera pas sur tous les fronts. La vraie question est de savoir où elle veut être indispensable.